

Couches est un site très ancien puisque on trouve un groupe de menhirs datant de 3 à 4000 ans.
D'autre part, les restes de la voie romaine Agrippa reliant Lyon à Autun sont encore visibles.
Le prieuré tomba en la possession d'un vassal des comtes de Chalon. Il ne restait alors plus qu'un prêtre pour le service religieux des habitants.Une partie de ces terres était devenue un fief rattaché à un petit château fort construit à cette époque, le premier château de Couches. Edifié sur un éperon rocheux c'était une tour de gué en bois dominant la vallée de la Vielle, lieu de passage important.
Au début du XIe siècle, l'évêque d'Autun, Helmoin, obtint avec l'appui du comte de Chalon la restitution du monastère et d'une partie des terres voisines.
Pour assurer la vitalité et la protection du monastère ressuscité mais amoindri, Helmoin en 1026 fit reconnaître l'union de celui-ci à l'abbaye de Flavigny par une charte signée du Roi de France Robert, de son fils le futur Henri Ier et d'une vingtaine de grands personnages, évêques, abbés, comtes.
Au point de vue féodal, l'abbaye de Flavigny dépendait de l'évêque d'Autun qui n'avait pas toujours une force militaire suffisante pour protéger le monastère St Georges.
En 1187 un contrat de pariage entre le Roi de France Philippe Auguste et l'abbaye de Flavigny assure à Couches la protection du Roi avec la présence d'un prévôt royal. En contrepartie des redevances étaient perçues par le bailli royal de Mâcon. tandis que le château de Couches était depuis le milieu du XIIIe siècle sous la suzeraineté du duc de Bourgogne.
Ainsi le bourg de Couches devint "Couches en royauté". Une forteresse militaire (la Tour Guérin) fut construite pour abriter les archers du Roi de France qui protégeaient les biens du prieuré (à l'origine abbaye Bénédictine).
Le fief seigneurial du château resta "Couches en duché".
La Tour Bajole, maison de trois étages aux petites fenêtres à meneaux et à la façade romane date du XIIe Siècle. Elle aurait été utilisée comme Palais de justice du Prévôt Royal (d'où son appelation de tour Bajol, tour du Bayulus, du Bailli).
Cette explication n'est cependant pas la seule : certains pensent que la Tour Bajole dépendait du monastère tout proche et aurait été cédé à un ventier du nom de Bizola (il aurait ainsi donné son nom à la maison).
Le ventier était un fonctionnaire attaché au prieuré qui avait pour tâche de recouvrer les droits et les taxes. Il était libre et franc de toute corvée. La charge était héréditaire.
Au cours des années 1438-1441, les "écorcheurs", l'une des compagnies de brigands qui semaient la terreur au Moyen Age, pillèrent et saccagèrent Couches et les environs. Nul doute que le prieuré reçu leur visite.
Antoine de Clugny, prieur en 1463, restaura l'église du prieuré et y fonda la chapelle en l'honneur de St Jean l'Evangéliste et de Ste Madeleine.
Lorsque le prieuré fut fortifié, les trois absides "en cul de four" que nous voyons aujourd'hui furent surélevées (à l'origine le prieuré en comptait cinq).
Sous l'église, les caves voûtées servaient de crypte aux moines les plus importants.
Un sarcophage a d'ailleurs été retrouvé et exposé dans le maître autel du prieuré.
Les voûtes à nervures qui sont en avant des absides, le portail et les fenêtres à vitraux sont l'œuvre d'Antoine de Clugny.
La fameuse poutre ornée de pampres et de deux têtes d'animaux fantastiques est supposée évoquer une représentation de la Vivre.
Cette œuvre est due au prieur Etienne de Neufville et porte la date du 8 janvier 1456.
Un des vitaux représente deux clefs entrelacées, blason de la famille de Clugny d'Autun.
Au-dessus de l'entrée de la deuxième cour, la coquille St Jacques rappelle que Couches se trouvait sur la route du pèlerinage de St Jacques de Compostelle.
La vie monacale reprend son cours mais en 1620, les bâtiments sont rachetés par la ville d'Autun. Le prieuré devient alors une résidence d'été pour un collège de jésuites.
En 1655, le prieuré achète le domaine de la Croix Vallot qui deviendra maison de repos pour les professeurs de ce collège d'Autun.
Les jésuites enseigneront et administreront les biens du prieuré jusqu'en 1762, date d'un édit royal leur retirant le droit d'enseigner.
Dans la tourmente de la révolution, le prieuré est saisi comme bien national, morcelé et vendu en lot. Les tours sont rasées sauf une (la tour des archives).
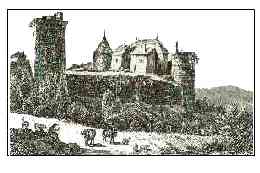
|
A la fin du XIe siècle, le 1er seigneur dont on connaisse le nom, Gaudry, entreprend les premières constructions importantes du château. Le donjon date de cette époque. |
Les extensions des bâtiments et des tours de défense indiquent la prospérité des seigneurs.
A la fin du XIIe siècle, le château passe par mariage en la possession de Hugues, seigneur de la Roche-Nolay (Rochepot).
Dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, Hugues descendant de Hugues et neveu de Hugues de Sully fondateur du prieuré du Val St Benoît, donne au château son plus grand accroissement.(voir le plan du château à travers les âges).
Marie, petite fille de Hugues, héritière du château fut mariée à Etienne de Montaigu-Bourgogne. De sang royal Capétien, il descendait du duc de Bourgogne Hugues III.
Marguerite de Bourgogne, fille du duc Robert II, petite fille de Saint Louis par sa mère Agnès de France, épouse de Louis X le Hutin fut répudiée pour adultère et enfermée dans la forteresse de Château-Gaillard (Normandie).
D'après des recherches très serieuses, Marguerite de Bourgogne ne serait pas morte en 1315 à Château-Gaillard comme nous l'apprend l'histoire, mais elle aurait été recueillie par sa cousine Marie de Couches et tenue secrétement prisonnière au château.
Certains documents attesteraient de sa mort en 1333.
Claude de Montaigu, dernier seigneur de Couches, fit de grands travaux dans le château. Nommé chevalier de la Toison d'Or en 1468, il fonda la chapelle consacrée en 1469 par le Cardinal Rolin, évêque d'Autun.
Un chapitre de 6 chanoines y vivaient en permanence.
Claude de Montaigu fut tué par les soldats de Louis XI en 1470 et le château passa en héritage à son cousin germain, Claude de Blaizy.
Au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, différentes familles nobles se succédèrent par mariage ou par héritage.
A la révolution, le château fut vendu comme bien national et subit de nombreuses destructions.
Au XVIe siècle, Couches fut désigné pour recevoir une colonie de riches protestants suisses.
Commerçants, ils s'établirent dans le village afin de répandre leur religion.
Ils construisirent un temple et une maison toute proche pour le pasteur.
Cette maison, connue aujourd'hui sous le nom de "vieil hôpital" porte la date de 1565. Elle fut transformée par un édit de Louis XIV en hôpital de neuf lits.
Ces riches protestants construisirent en 1610 une école pour enfants protestants.
Après la révocation de l'Edit de Nantes en 1685, cette école offrit l'hospitalité au pasteur et aux fidèles de l'église réformée et abritait dans ces murs un petit temple.
C'est ainsi que cette maison porte le nom de "maison des Templiers" (dans le langage populaire, les "Templiers" étant des gens qui fréquentaient le temple).
Cette maison est classée monument historique
|
|
|